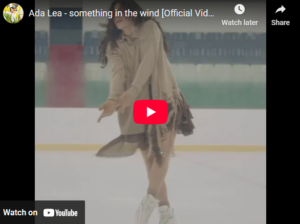Alexandra Levy, connue sous le nom d’Ada Lea, se tient toujours à mi-chemin entre deux mondes : la peinture et la musique. Sur la pochette de son nouvel album, when i paint my masterpiece, elle pose entourée de ses toiles. Comme si ces deux langages finissaient par se répondre.

« Je peins souvent en laissant l’image se présenter à moi. Je me suis dit : comment je pourrais faire la même chose avec la musique ? », explique-t-elle.
Après des années de tournées qui l’ont menée d’un continent à l’autre, Ada Lea a voulu reprendre la main sur son rythme. « Je voulais un album qui ne sonnerait pas comme une machine. Je voulais que ça sonne humain », dit-elle.
Avec son groupe composé de Tasy Hudson, Summer Kodama et Chris Hauer, ainsi qu’avec le producteur Luke Temple, elle a enregistré en direct, sans clic, dans une approche résolument organique. « On a fait des takes au complet. On avait beaucoup joué ensemble, alors je voulais avoir ce son-là… celui qui est vivant. » On entend donc les imperfections, souhaitées et souhaitables, rendant chacune des seize chansons empreintes d’une sincérité difficile à égaler.
L’écriture s’est teintée d’une forme de lâcher-prise : « Stream of consciousness… les surréalistes faisaient ça, raconte-t-elle. Tu écris et tu laisses s’installer n’importe quoi qui vient. J’ai senti ma grande fatigue se placer subtilement à travers les paroles, comme un besoin de repos, mais beaucoup de lumière aussi et d’images fortes. »
En Europe, cet été, elle s’est sentie portée. « Au Royaume-Uni, je ne sais pas si c’est parce que j’ai trois albums, mais les gens ont eu le temps de devenir des adeptes. J’étais vraiment surprise, car on me célébrait », rapporte Ada Lea.
Alors qu’elle était la première partie durant la majeure partie de sa récente tournée européenne, à Londres, elle a appris le jour même qu’elle était la tête d’affiche. Je craignais que personne ne reste, mais c’était complet. Les gens étaient là et ils aimaient vraiment ma musique. » Le magazine numérique londonien When The Horn Blows a d’ailleurs décrit son nouvel album comme un « chef-d’œuvre de storytelling ».

Ada Lea lors de son passage au FME à Rouyn-Noranda le 31 août 2025 (crédit : Élise Jetté)
Mais l’expérience européenne est loin de ce qu’elle vit au Québec. « Je voulais faire une performance à Québec en 2022 et le show a été annulé parce qu’on a vendu zéro billet, se souvient-elle. C’est seulement un exemple, mais c’est comme s’il n’y avait pas vraiment de public pour ma musique dans la province. Je me sens un peu isolée. »
Si nulle n’est prophétesse en son pays, l’autrice-compositrice-interprète rêve d’une reconnaissance chez elle, au Québec. Car même aux États-Unis, le succès de ses albums est retentissant. Pitchfork lui décerne 7,3/10 pour when i paint my masterpiece, en mentionnant que c’est son album le plus « globalement équilibré ». Un autre média américain respecté, Paste Magazine, parle de l’écriture d’Ada Lea sur son troisième album comme étant « si idyllique qu’elle frise le surréalisme ». Le média new-yorkais Stereogum livre à son plus récent disque un déferlement de compliments : « L’album trouve un équilibre délicat : il donne l’impression d’une effusion du cœur et de l’âme de Levy, mais comme si elle avait soigneusement étudié chaque étape. ».
À Montréal, où elle vit, Ada Lea peine à trouver l’appui dont bénéficient nombre de ses pairs francophones. « Je fais mes trucs toute seule. C’est DIY. La plupart des artistes québécois que je connais sont entourés de plusieurs personnes qui semblent connaître la recette pour que les projets fonctionnent ici. Mais moi, j’ai souvent l’impression d’avoir 25 chapeaux sur la tête. »
Elle reconnaît que la langue joue peut-être contre elle. « Je pense que ça se peut que l’anglais, ce soit un deal breaker. Je devrais peut-être écrire plus en français, faire plus de collaborations. Mais pour l’instant, c’est encore plus naturel pour moi d’écrire en anglais », précise-t-elle. Elle garde pourtant des modèles comme Leonard Cohen en tête : « Son image est partout à Montréal, il est sur des timbres et les bâtiments, énumère-t-elle. Et comme moi, il est anglophone… Je me dis que si la musique est assez bonne, la barrière de la langue pourra être traversée. »
L’artiste n’ignore pas la fragilité de sa position. « Le CALQ (Conseil des arts et des lettres du Québec) finance entre 3 % et 5 % de projets musicaux anglophones chaque année, explique-t-elle. C’est difficile d’être parmi les personnes élues. » Mais malgré les obstacles, elle refuse de plier. « Même si c’est difficile maintenant, si je continue à écrire, à lire, à développer mes habiletés musicales, éventuellement je vais être reconnue ici. »
Avant de proposer ce troisième album, paru en août, Alexandra Levy a pris du recul, elle est retournée à l’école, a multiplié les cours de peinture et les lectures. Elle dessine encore, dès qu’elle le peut, même en tournée. « J’apporte toujours des crayons. C’est en dessinant que je me dépose », explique l’artiste. Cette pratique visuelle l’aide à concevoir ses chansons autrement. « J’ai réalisé que je laissais l’image se présenter et que je suivais le flow. Je veux combler le fossé entre les chansons et l’art visuel. »
Ses chansons deviennent ainsi les délicats portraits de situations ou d’émotions vives qui, en fermant les yeux, deviennent de grandes fresques qu’on peut imaginer et réinventer à chaque écoute.
when i paint my masterpiece n’est pas un album qui cherche à briller par la perfection. C’est un disque qui respire, qui laisse passer les erreurs, qui se nourrit de leur humanité. « Les chansons peuvent respirer. On n’est pas des robots, alors c’est correct de laisser les moments un peu sketchy, pas parfaits parfaits. »
En laissant la peinture sortir des lignes, Ada Lea propose une œuvre où chaque note est un trait de pinceau, tantôt spontané, tantôt extrêmement précis. Ses chansons sont le témoignage d’un processus. Et si elles refusent les chansons parfaites, c’est pour mieux affirmer leur vérité.